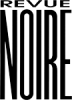On ne tue pas un homme qui chante...
par Jean Loup Pivin
La ville s’étend et court sur les collines en entassant ses toits rouges et verts. La lune brille dans le ciel ensoleillé. Le bleu pur, profond, poudreux, endort les nuits noires. L’impuissance à séduire coule dans les veines. Les images pleuvent hirsutes par milliers dans l’œil décervelé. Les voyages bousculés transportent l’immobile être rongé par sa propre mémoire, par sa propre expérience. Les portes de l’hôtel donnent sur les rues interdites aux pieds fouleurs, seule la voiture permet de vraiment sortir par le sous-sol anodin. Derrière les vitres les visages deviennent sombres et aperçus dans l’éclair de la vitesse automobile, ceux alors que vos pieds essayaient vainement de croiser avec les leurs. De demi-tour en vitesse accélérée pour ne pas se trouver coincés par la folie d’un regard aviné et avide des quelques biens portés par une chair que l’on craint de voir abîmée, jetée, violée.
L’angoisse de rester nu sans rien dans un pays que l’on ne veut pas connaître tant il vous contraint à vous défendre sans cesse, à vous défendre d’être blanc alors que vous n’êtes que blanc, à vous défendre d’être noir alors que vous n’êtes que noir, à vous défendre d’être riche d’une richesse dont vous ignoriez qu’elle existât dans une insolence tellement flagrante, tellement injuste, tellement ridicule. Il est interdit d’être innocent ici, on est coupable de naissance sans autre jugement : le partage obligé d’une conscience qui vous était inconnue. La haine sans le moindre rire de folie, la haine froide, triste, suicidaire pour ne rien recouvrer, pour ne rien gagner, pour ne rien découvrir. Finalement, une haine urbaine.
Le rire est mort dans ce pays fratricide plein de morale et de bonne conscience. Meurtre fratricide pour celui qui veut croire à une humanité de différences. Le meurtre n’est pas fratricide ici, il s’agit de tuer l’autre comme un insecte, une vipère ou le diable lui-même : ils n’ont jamais été frères et ne le seront jamais. Le cauchemar américain dans une Afrique où plus personne n’est chez lui, sinon dans ce chez lui qui prend à l’autre ce que l’autre ne cherche pas vraiment à avoir. Une voiture, une maison et un job mais pourquoi faire, pourquoi vivre, sinon un sinistre état de paix dont plus personne aujourd’hui n’est convaincu et qu’aucune société n’a plus à rien offrir.
Les temps meilleurs n’obéissent à aucune nostalgie d’un passé perdu, à tout jamais perdu. Le vrai destin d’un peuple est probablement de ne plus être un peuple. On dit l’individualisme, mais c’est simplement la solitude qui envahit chaque esprit, chaque maillon de chaque action. La décomposition s’accompagne d’une recomposition inouïe, inimaginable. Il n’y a plus de projection d’une autre image, il n’y a que des enfermements dans des particularismes musicaux, sensoriels, sexuels, spirituels.
Je ne veux pas croire aux évidences de l’histoire reconstruite par les preuves de la science. Mes religions m’interdisent de croire à l’évolutionnisme : l’homme ne descend pas du singe, il est né comme il est. Point. Alors je ne veux pas entendre, voir. Mon esprit se gâte par mon désir de comprendre et par ma lassitude à comprendre. Le rire n’est pas scientifique. Et pourtant la science a libéré l’homme et elle a crée l’universel, elle a aboli les différences de races, elle a rassemblé l’homme autour de la seule matérialité du corps et de la cervelle, elle seule permet l’universel, elle seule permet de construire l’universel. Reste alors l’art et l’amour qui peuvent faire le reste. Au philosophe de redevenir sage.
Mais la science aussi a fait croire qu’elle pouvait maîtriser l’esprit. En envahissant l’art et l’amour, elle a donné au raisonnement une puissance qu’il ne pouvait pas avoir. L’humanité scientifique a tordu le cou à l’inspiration et à l’amour. Les politiques, toujours, se sont emparés du discours de la raison pour démontrer, expliquer et parer tout ce qui est de l’humain des plumes de la raison. Les intellectuels nous ont fait croire qu’ils pouvaient décrire et comprendre la réalité de l’homme par la science. La science n’a jamais fabriqué de la réalité, elle ne l’a que regardé; bien entre le zéro et l’infini, mal dans l’âme.
Le désert souffle sa chaleur sur la ville. Deux nuages noirs passent et semblent annoncer une pluie. Tout devient inutile. Même les pierres plaquées sur les façades de béton. Les yeux tombent dans des visages qui n’arrêtent pas d’être attirés par la terre, le sol. Ma pensée latine ne cesse de s’appauvrir et me fait souffrir. Je ne cherche même plus à communiquer tant tout semble soudain vain. Je n’ai jamais voulu rien dire aux autres, simplement me sentir vibrer par mes propres sons et une pensée que je croyais organisée. Je ne sais pas chanter. Cela aurait peut-être mieux valu : on ne tue pas un homme qui chante. Pourquoi croire cela, puisque cela aussi est faux, démenti par une quelconque histoire. Pourtant j’aimerais tant croire que l’on ne tue pas un homme qui chante.
***
par Jean Loup Pivin
(publié dans le magazine Revue Noire RN11, South Africa, décembre 1993)
.