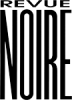Marcel Zang est né au Cameroun en 1954 et décédé en 2016 à Nantes. Arrivé en France en 1963, il s'installe à Nantes, après des études de Lettres à Nanterre. Il a publié plusieurs nouvelles dans le quotidien Libération et dans des revues littéraires . Il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre ('Mon Général', 'L'Exilé', ’La danse du Pharaon').
***
La Dette
[publié dans RN 04 en mars 1992, texte inédit original en français]
C’était à Nantes, au plus fort de l'hiver ; et comme j'en avais récemment pris l'habitude, je me tenais ce jour-là accroupi ; je lisais, je rêvassais – cependant qu'une gamme de sentiments autrefois connus effleuraient les touches du piano et se dressaient à mon passage, tels des fantômes d'un cercueil ; bâtonnets de cendre au baiser vertigineux soutenant ces bribes de cerveau, fétus planant dans l'air, léger, léger, libre, et qui peu à peu se redéposaient – pour former un bloc compact. Une taie. Une statue.
Et, prisonnier de ce trouble silence, chaos recroquevillé, rien ne me rappelait plus le dur écoulement du temps – prurit – qu'une maison, un foyer, ce sang, lignée de marmaille, l'ornement intérieur, la solidité du mobilier, fauteuil, ce fauteuil, cette paralysie polie des objets, baguette, mille mouvements, symphonie, somme tragique, cimetière d'étincelles. Résistance à la mort. Mort du père. La queue dans le bénitier – ce qui en restait. Mollusque aux rebords accroché. Excentrée. Evincée. Mais de cette libre obscurité, où désormais pouvait peindre une lumière à ma guise et projeter un verbe à ma mesure, me revenaient, au lieu de cela, ces filaments de fantômes. Terribles poinçons. Gelée fœtale.
Balbutiement. Résistance à la mort, disait-il. Instinct fondamental. Résistance à la mort. Instinct de conservation. Finalité de la vie : la vie, disait-il encore. Hein, c'était mon papa ! Plus fort que le plus fort des plus forts de tout le monde entier. Plus grand que l'arbre le plus grand. Insoutenable. Puis savait tout : Papa, bien vrai que tu mourras jamais ? Jamais, jamais, jamais ? … Mais alors, avant le commencement qu'est-ce qu'il y a ? Et après Dieu qu'est-ce qu'il y a ? Et après, après, après… mille millions après toi ? Toujours et évidemment lui, mon papa. Savait tout. Comprenait tout : moi, le haut, le bas, le large, tout. Tout. Tout, il était : et commencement, et fin, me serinait-il. Centre . Centre des centres. Et je l'écoutais, et j'épousais. Dès lors, comment de cette horde primitive de Totem et Tabou pouvais-je éprouver la moindre sympathie ?
Puis la sonnette a retenti. J'ai repoussé l'entretien de Bram Van Veld et je suis allé ouvrir. Il avait cinquante six ans ; j'en avais alors dix-huit. Il les faisait plus que jamais – lui, toujours reluisant et jeune comme un tambour, d'une exubérance parfois lancinante. Il est entré, solennel, empesé, et sans préambule m'a dit que sa mère était morte. Un coup de fil ce matin . Je l'ai pris et je l'ai déposé avec précaution devant quelques verres de rouge . Puis il s'est mis à parler, à rentrer dans les détails, fouaillant les épines ; et toute l'aura de gravité dont il s'était drapé à l'entrée a commencé à virer au rouge, un rouge de plus en plus clair, à mesure qu'il égrenait ses mots.
Tu peux pas savoir comme ça me fait souffrir. Et c'est vrai qu'il souffrait, c'est à dire qu'il paraissait tour à tour abattu, désemparé, puis furieux. Où que tu ailles faut qu'on vienne te faire chier avec la souffrance, marmonnait-il. Cette femme est morte... On me dit que c'était ma mère... Tu comprends ça, toi? Je la connaissais pas, elle nous a quittés quand j'avais quatre ans et je l'ai jamais revue depuis, jamais. Je ne la connaissais pas, je ne me souviens de rien, je ne me souviens pas d'elle, pas la moindre impression, le moindre détail, qu'elle m'a touché un jour, qu'elle m'a dit, donné ou refusé ceci ou cela, qu'elle m'a engueulé, battu, aimé ou caressé... Rien ! Rien de rien. Le blanc. Le blanc total. C'est pas normal. Et voilà qu’on m'apprend qu'elle est morte. Et sa mort me fait souffrir. Ça me fait mal, Max, terriblement mal. J'aimerais savoir au moins qui était cette femme, faut que je sache, que je demande à mon père, qu'il me dise qui était cette femme qu'on dit que c'était ma mère, qu'il me le dise. Je veux savoir qui elle était, j'ai le droit de savoir... Tu comprends ça, petit frère ? Je veux savoir... savoir pourquoi. Je la connais pas. Cette femme je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas du tout ! Mais, putain, je ne la connaissais pas ! – puis il a éclaté en sanglots, des gros bouillons : Max, petit frère, je te jure sur la tête de ma mère que je ne la connaissais pas, cette femme. Et sa mort me fait tellement souffrir. Putain, c'est pas vrai ! Et je ne la connaissais pas du tout. Et maintenant... Je suis le fils aîné, on m'attend, tout le monde m'attend, tous, tous, ils m'attendent, et ça fait quarante ans que j'ai pas mis les pieds au pays, et faut que j'aille présider les cérémonies de deuil, organiser les festivités, apporter des présents à tout le monde, faire ci, faire ça, toutes ces conneries, la tradition, la coutume, le pays, ma mère, ma mère qui est morte, morte comme si elle n'était pas morte, mais elle est morte et ça me fait terriblement souffrir. Et tout le monde m'attend, on n'attend plus que moi, après quarante ans, et tout ça parce que cette femme que je ne connaissais pas est morte. C’était ma mère, et tu ne sais pas comme sa mort me fait souffrir. Je ne la connaissais même pas ! Je ne la connaissais pas, cette femme… . Je ne la connaissais pas…
Elle nous a quittés tout gosses, et voici maintenant qu'elle réapparait avec cette mort. Faut maintenant que je rentre au pays. Si je me démerde bien, si je frappe aux bonnes portes, je peux trouver de quoi me payer un billet d'avion, c'est rien ça, un billet d' avion, je peux trouver, mais ça suffit pas, je peux pas m'amener les mains vides, les poches vides, et rien qu'avec mes costards, et tu sais que j'en ai, que je pourrais en changer tous les jours et tenir une semaine, voire même deux, mais après… Hein, après ? … Comment je ferai ? Après quarante ans, quand ta mère est morte, les meilleurs costards du monde ça suffit pas, ça sert à rien si t'as que ça. Je sais qu'ils m'attendent tous, je les renifle d'ici qu’ils m'attendent, tout ça parce que ma mère est morte. Je ne la connaissais pas, cette femme, et je voudrais la connaître, savoir qui elle était pour faire ça, qu'on me dise, pourquoi elle fait ça, alors que j'étais tranquille ici, et voici maintenant que je suis obligé de retourner là-bas. Je connais plus l'Afrique, le Cameroun, je n’ai aucune envie d'y foutre les pattes, je suis bien ici, mais il faut que j’y aille, que je sache pour ma mère, pour moi, que je la connaisse, et si j'y vais pas, tout le monde ici, tous les Camerounais de Nantes vont se foutre de ma gueule, que j'ai pas de quoi assurer pour la mort de ma mère… vont même parler de sacrilège, avec tous les autres là-bas au pays... après quarante ans, qui me croient architecte, plein de fric… comprendront pas… Et tu peux pas chier ta mère, c'est des trucs qui se font pas chez nous, que tu montes, que tu descendes.
Max, tu es jeune, mais tu es africain, camerounais, comme moi, et tu connais ça : tu ne peux pas chier ta mère, ou alors tu es maudit. Et ces bougnoules là-bas au pays qui me croient plein de fric, architecte… Bande de connards ! … Savent pas tout ce que j'ai bâti, tous les culs de bonnes femmes que j'ai bâti ici en France, savent pas ce que c'est, la création... créer... peuvent pas comprendre ça, ces sauvages ! Faut de la sensibilité d'artiste pour faire jaillir une étoile d'un fumier de cul de merde. Savent pas ce que ça représente . Et je sais bien que ça leur suffira pas si je m'amène au pays rien qu’avec mes beaux costards, avec toutes les blanchettes que j'ai sautées et tous les parfums de foutre... Connaissent pas la Beauté, vont juste me prendre pour une lavette. Comment veux-tu que j'aille vivre dans un coin aussi tordu, où plus tu tombes des nanas et plus ils te prennent pour une gonzesse. Tu ne sais pas... Je me sens atteint, humilié. Ah, Max, cette mort me fait vraiment souffrir. Et dire que je la connaissais même pas, cette femme, mais c'était ma mère, c'est ma mère qui est morte, et je suis le fils aîné, et faut que j'y aille, mais comment faire, petit frère ? Et tout le monde sait que c'était ma mère.
Je me suis levé et j'ai mis une cassette de Schubert. Enlève-moi cette foutue musique de Blancs ! Il a aboyé en renversant son verre de vin. C'est ma mère qui est morte, t'as pas trop l'air de réaliser ça. Ma mère est morte, morte, morte... Mets-moi une musique de chez nous, un truc africain, une chanson camerounaise. C'est des cons, mais c'est pour ma mère, c'est elle qui est morte. J'ai donc mis une musique camerounaise, une chanson d'Eboa Lottin. Il n'a pas pu se retenir, et les larmes ont ruisselé : je ne la connaissais pas, ne cessait-il de balbutier, je ne connais pas cette femme ; puis il a dit que ça lui faisait du bien d'écouter cette musique, qu'il aimait beaucoup, que c'était sa mère qui était morte, qu'il avait le droit de pleurer et de se saouler la gueule devant tant de souffrance. Faut que je me démerde pour réserver une place d'avion, il a dit. Une femme que je ne connaissais pas ... Si c'était mon père qui était mort ainsi, j’aurais compris, je serais parti en Afrique sur-le-champ, même à pied, fric ou pas fric. Mon père c'est autre chose. Mon père ? ! ... Merde alors! ... Ce bonhomme m'a écrasé d'amour, intouchable, terrifiant, de fer.
Parlait-il de son père ou du mien ? Intouchable... C'est vrai que je me sentais gauche en sa présence, gêné, et il le semblait aussi, je le voyais. Comme il n'était pas d'un naturel bavard, nous demeurions quelquefois sur la véranda, le soir, alors que chaviraient les derniers rayons de soleil, et nous restions là, sans nous parler, côte à côte, le regard fixe, brûlant de choses non dites, tandis qu'au loin, mais si près, nous parvenaient ces accents aux choses faites, comme d'un minaret. Et j'éprouvais un énorme plaisir à être ainsi près de lui, dévidant l'un l'autre nos silences et cette tension qui nous raidissait. Ou alors, à son insu, je me postais dans un coin, loin de lui, loin, et des heures durant j'observais ce bloc monolithique, mystérieux que j'adorais. En vérité je ne pouvais supporter son regard. Quand j’avais besoin de quelque chose, je lui écrivais une lettre ; il m’accordait presque toujours ce que je lui avait demandé, et souvent même, avec un empressement pathétique. En revanche je ne pouvais endurer l'idée de lui avoir déplu par un acte quelconque ; dans ces moments là il se contentait de m'envelopper d'un long regard douloureux ; j'aurais tout donné pour ne pas sentir ce regard peser sur moi.
Et autant il était calme et taciturne, autant ma mère était volubile et agitée. Mon père la battait souvent. Mes petits frères et soeurs essayaient de les séparer quand ils en venaient ainsi aux mains ; moi je n'osais pas ; et les rares fois que je m'y suis risqué, mon père délaissait tous les autres pour me consacrer un regard d'une qualité unique. C'était un regard intensément nu, intime, mais si intime qu’il me donnait l'impression de me trouver, lui en moi, là, face à face, comme dans un sanctuaire, isolés du reste du monde. Et ce regard reflétait un éventail de sentiments qui allaient de l'étonnement le plus profond à l'indignation en passant par la douleur, la déception et la découverte d'une trahison, comme si nous avions été complices de je ne sais quoi de sacré. Alors je me retirais, meurtri, honteux, fautif, gêné d'avoir pénétré par effraction dans la quintessence d'un lieu de jouissance, d'une chose innommable, inconnue, que je ne désirais pas connaître, du moins pas encore. Ce regard contre lequel je butais me dépassait absolument. Après cela nous nous évitions, et une semaine pouvait s'écouler ainsi sans nous adresser la parole – une parole qu’il avait lourde, lourde comme son propre sexe.
Mon père s'est suicidé il y a une semaine, je lui ai dit. Il a bondi de sa chaise, m'a regardé, puis s'est donné deux coups de poing sur les tempes. Il a levé ensuite les bras et s'est mis comme un chimpanzé. J'ai mis une cassette : La Norma de Bellini.
Quand il avait bien bu, il lui arrivait de me dévisager: son expression surprise faisait place à une lueur d'égarement ; et des secondes après un lent sourire faisait fondre ses yeux ; c'est alors qu’il m'appelait par ce diminutif de mon enfance qu'il était seul à utiliser, le répétant, attachant, et séparant, et chaque syllabe, murmure. Et quand je l'entendais me caresser ainsi de sa voix, de cette voix, un âpre fluide me pénétrait, suivi d'une implosion de bonheur qui s'atténuait peu à peu en un état de bien-être, tandis que des frémissements continuaient à me parcourir.
J'ai regardé par la fenêtre. Des passants se hâtaient sous le froid, des oiseaux dessinaient des arabesques entre les flocons de neige, des arbres étiques tendaient leurs membres de criquets vers le ciel. Chagall écoeurant. Il m'a pris dans ses bras ; je lui ai dit que je n' irais pas ; il a dit que je devais et que nous irions ensemble, et qu’il m'y emmènerait de force s'il le fallait. Je lui ai dit qu'il n'y était pas. Que c'était une affaire personnelle. Affaire de vérité. Mais le visage extasié, il a oscillé des bras comme un albatros, et sous la musique il a dit: ''Ah, la Callas... comme c'est beau ! ".
Marcel Zang
***