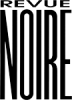et le romancier russe
par Simon Njami
Les lumières s'éteignent doucement. L'écran s'illumine. Quelques bruits de gorge, quelques sièges qui craquent, et le spectacle commence. Panoramique : un paysage dans le lointain. Un désert. La silhouette floue d'un cavalier s'avance. Plan-séquence : le cavalier s'avance vers nous jusqu'à ce que nous ayons pu distinguer ses traits, puis il s'arrête. Il retire son chapeau et s'essuie le visage avec un mouchoir à la propreté douteuse. Il remet son chapeau et s'avance de nouveau à notre rencontre en fixant un point qu'il nous est impossible de voir. Contre-champ : un petit village dont on distingue le clocher...
Pendant un temps qui ne sera jamais calculable, jamais quantifiable, nous voilà propulsés dans un univers autre. Un univers auquel ni la peinture, ni la photographie, ni la littérature, ni quelque forme d'art que ce soit ne donnera un accès aussi immédiat que ces images animées qui reproduisent si bien l'illusion d'une vie réelle, autonome. Le point commun, le seul peut-être que le cinéma entretienne avec les autres formes d'art est la notion de langage. Il y a ici, dans cette salle obscure, des clés, des codes, des sons, que l'apparente universalité de l'image rend accessibles à tout un chacun.
Enfant, lorsque mes parents m'entraînaient au cinéma à Douala, j'étais fasciné, non pas tant par les images qui bougeaient là-bas, devant moi, et qui me faisaient croire qu'une quelconque magie s'abritait derrière l'écran réfléchissant, que par le spectacle qui se déroulait dans la salle. Les hurlements, les cris, les prises de position du spectateur défendant avec véhémence tel ou tel personnage. Aujourd'hui, même si l'espoir informulé de voir les comédiens venir saluer à la fin de la représentation a disparu, demeure en moi le sentiment indélébile de cette nécessaire communion, de cette étrange impudeur qui, l'espace d'une séance, faisait chacun sortir de soi, par delà les spécificités des paysages et des coutumes. Cette alchimie qui nous faisait être Gary Cooper et Charlie Chaplin, et plus tard Sydney Poitier...
La couleur n'existait pas, n'existait plus. On devenait celui auquel une bande de truands avait donné rendez-vous dans le canyon de la mort. Notre vie dépendait de notre faculté de dégainer plus vite que l'autre. De courir plus vite. Et dans ces tragédies très conventionnelles, je me surprenais toujours à prendre le parti du méchant. Nombre de réalisateurs africains m'ont avoué avoir été influencés par ces mêmes personnages qui ont bercé mon enfance.
En Occident, les salles de cinéma sont comme des théâtres, des temples, où il vous est interdit de pleurer et de rire à trop haute voix. De serrer convulsivement le bras du voisin que vous ne connaissez pas. Dont vous ne sauriez pas reconnaître le visage sitôt la porte de la salle franchie. Cette fraternité d'un moment m'a manqué. J'ai appris moi aussi à ne plus rire, à ne plus pleurer à voix haute. J'ai appris à sortir de la salle avec le visage triste de qui vient d'assister à une conférence particulièrement rasoire. Et j'attends patiemment que d'autres histoires viennent me sortir de cette mort lente. De cet intellectualisme qui tue tout sentiment et qui à la place, nous condamne à être les analystes de la folie des autres.
J'avais espéré que le cinéma africain me ramènerait mon enfance, et la joie particulière de ces moments de récréation. Sauf quelques tentatives heureuses ici et là, il n'en a rien été. Je n'ai pas compris. J'ai même failli renoncer à attendre. Si comme je le disais, le cinéma est langage, le cinéma africain n'avait pas encore trouvé le sien. Alors que je croyais pouvoir baigner encore dans une chaleur au coeur de laquelle je pourrais me réchauffer, une vision du monde qui m'aurait réconcilié avec mon histoire personnelle compliquée, j'ai découvert avec stupeur que l'ombre de Gary Cooper planait toujours, à jamais imprimée sur les tissus de ma mémoire. Pourtant, je ne suis pas Gary Cooper. Je n'ai rien à voir avec lui. Pas plus en tout cas qu'avec tel ou tel personnage de film africain. Alors quoi ?
Peut-être Gary avait-il voulu me parler à moi, personnellement, alors que les autres se fichaient de savoir si oui ou non j'existais quelque part. Peut-être que dans l'extrême simplicité même des films dans lesquels il jouait, se trouvait le secret de la magie qui a opéré. Les réalisateurs qui l'ont fait travailler, les scénaristes qui ont écrit pour lui n'ont pas dû tant écrire pour lui que pour moi. J'aime les films dont j'ai le sentiment qu'ils ont été faits pour moi. Par-delà les années et les kilomètres. Et les cinéastes africains ont été égocentriques pour me prêter une oreille favorable. Pourtant, je ne demande pas grand chose. Une histoire, à peine. Des personnages ? Oui. Certainement. Des personnages dans la peau desquels je puisse entrer, comme dans un roman russe du dix-neuvième siècle. Le romancier russe du dix-neuvième siècle ne me connaissait pas. Pourtant lui aussi a écrit pour moi, en fouillant au fin fond de son être pour y trouver ce qu'il pourrait me communiquer et que je pourrais comprendre, admettre.
Comprendre n'est pas tout, bien sûr. Mais sentir que l'on peut comprendre est essentiel. Que l'on n'est pas totalement exclu. Me sentant exclu par les cinéastes africains, je me suis détaché d'eux doucement, comme on se détache d'un amour dont on sait qu'il n'y a plus rien à attendre. En attendant...
Aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai probablement été trop injuste. Que je me suis comporté comme un petit frère abusif qui attend tout trop vite de son grand frère forcément génial.
***
par Simon Njami, octobre 2009
(publié dans le magazine Revue Noire RN08, Le cinéma african, mars 1993)
.