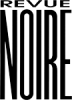Alberto Lauro est né en 1959 à Holguín, Cuba. Poète, écrivain, il a reçu plusieurs prix dans des concours littéraires à Cuba où a été publié ses recueils.
Publications à Cuba : 'Con la misma furia de la primavera' (Avec la même fureur du printemps) 1986 ; 'Los tesoros del duende' (Les trésors du lutin) 1987 ; 'Acuarelas' (Aquarelles) 1980 ;
Publications en Espagne : 'Parabolas y otros poemas' (Paraboles et autres poèmes) à Barcelone, 1987.
***
pour Reinaldo Arenas
[publié dans RN 09 Caraïbes en décembre 1992,
texte original en Espagnol-Cuba
traduit en français par Orlando Alomá]
Li
Un beau garçon, assassin de 15 ans, dit avec dégoût ton nom lu sur le mur d’un urinoir.
Ne crains rien.
Il montera les escaliers de ta chambre.
Là, ta présence présage un autre vide.
Déserteur de la fête.
Suicide de la neige.
Roi guillotiné.
Alberto Lauro, extrait de 'Conversation avec Rimbaud'
***
Testament
Pour Reinaldo Arenas
Ardu a été le combat.
Le démon s’est acharné contre toi.
Tu as voulu le chasser de ton corps
à coups de fouet. Dans les cilices
tu l’as attrapé. Ce fut inutile.
Il était là,
en jetant sur la boue
de ton cœur des cendres
de mots amers.
Seigneur, prie pour mon frère.
Dans ses derniers instants,
accompagne-le. Et quand il ira vers toi
dis-lui : « Allons ».
Comme au larron
qui au lendemain
de sa mort
se réveilla dans ton royaume.
Alberto Lauro, extrait de 'Paroles dans le désert'
***
Dernières conversations avec Reinaldo Arenas
Les images que je garde de Reinaldo Arenas s’estompent et le rendent chaque fois plus net dans l’impalpable royaume de la mémoire. Un de mes derniers entretiens avec lui eut lieu pendant l’été 1990. Je me trouvais dans un coin perdu de l’Italie et lui à New York. Je n’enregistrai pas la conversation. Je ne voulais pas conserver la voix de quelqu’un qui avait la pleine lucidité de la mort, de sa fin totale, car Rei – c’est ainsi que nous, les amis, l’appelions – était un athée convaincu. Il a suffi d’un court instant pour qu’à nouveau soit établi entre nous l’enchantement que provoquait sa conversation pleine de sagacité et d’ironie mordante et corrosive. Il jouait à être ’l’enfant terrible’* de la littérature cubaine. Cela le fascinait. La vie, pour lui, était littérature. Et vice versa. Presque au même âge où Raymond Radiguet écrivait ’Le Diable au corps’, il terminait son premier roman ’Celestino antes del alba’ (Le Puits) qui le fit connaître. Il en avait écrit auparavant un autre, qu’il considérait uniquement comme un exercice. ’Celestino antes del alba’ fut célébré par Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier et tous les noms célèbres de la littérature cubaine. Il paya très cher son audace, un prix trop élevé alors que son intention était fondamentalement innocente. Ses méchancetés, mêmes celles faites à ses amis les plus proches, avaient pour seul but de divertir. On ne le comprit point. Il s’amusait de cette équivoque.
À l’autre bout du téléphone, il me parlait, heureux face à cet appareil inventé par les hommes pour tromper les frontières. Je devinais sa nervosité à travers le calme de ses mots choisis, à l’inverse de son débit verbal coutumier, semblable à celui de sa mère. Il me dit s’amuser à lire ma correspondance à nos amis communs où je donnais des nouvelles de Holguín. Cette ville située à l’intérieur du pays où nous étions nés et où nous avions passé, à des périodes différentes, les premières années de notre enfance et de notre adolescence, fut le cadre de son roman ’El palacios de las blanquísimas mofetas’ (Le palais des très blanches mouffettes). Dans ce livre, ainsi que dans ses récits ’Comienza el desfile’ (Le défilé commence) ou ’Bestial entre las flores’ (Bestial parmi les fleurs)**, sont présent des amis qu’il a dépeints avec une grâce incomparable. Comme je connaissais à la fois la réalité et la fiction littéraire, je pouvais jouir de son talent avec une délicieuse complicité.
Il me demanda des nouvelles de ceux qui se trouvaient encore à Cuba – le fils du peintre Ponce de Léon, le peintre Armando Gomez, Delfin Prats, la peintre Clara Morera... – et d’autres, parmi lesquels figuraient quelques-uns qui auraient mérité de recevoir un certificat comme ceux qu’il avait expédiés ’officiellement’ et dans les règles, et par lesquels il signifiait à ses correspondants leur exclusion de son cercle d’amis ; il avait envoyé un de ces certificats au poète Nicolás Guillén. Il me raconta du début à la fin un roman qu’il voulait écrire sur Clara. Celle-ci était finalement surprise par la police en train de plagier des tableaux de Jérôme Bosch avec une telle maîtrise que la critique douta même de l’existence du peintre. Avant d’être emprisonnée, elle transforma en immense bûcher sa maison et ses tableaux. C’est une fin semblable à celle de son récit ’La vieja Rosa’ (La vieille Rosa)**, un de ses écrits littéraires le plus remarquable, je pense. À ce, il me répondit que pour Clara, dans un tel contexte, il ne voyait pas d’autre issue.
Il me demanda d’aller rendre visite à sa mère. Elle était devenue une créature sans défense face à la solitude. Lors de la veillée funèbre de l’écrivain Virgilio Piñera, je me souviens d’un jeune dramaturge aux yeux très bleus se rapprochant de Reinaldo. Il lui dire que le défunt pensait qu’il n’était pas né un écrivain de sa dimension depuis Lezama Lima et Cabrera Infante. Je ne connus pas sa réaction. Quelqu’un m’assura qu’il pleura. Ce qui est certain, c’est qu’il partit. Les embaumeurs n’avaient pas encore remis le cadavre de Virgilio Piñera que les funérailles commencèrent. Reinaldo réapparut. Nous pensions que tu étais parti – lui dit quelqu’un. Non – répondit-il, en parodiant l’illustre poème de Césaire – j’allai célébrer avec un café le retour du défunt à son pays natal.
Il me parla des personnes qui lui furent essentielles dans les dernières années : le réalisateur Néstor Almendros, l’écrivain Roberto Valero, le peintre cubain, résident à Paris, Jorge Camacho et sa femme... Ensuite, il reparla de sa mère, la personne préférée. Et finalement arriva à un de ses sujets favoris : La Havane. Il s’en inspira ainsi que du roman colonial cubain ’Cecilia Valdés’, de Cirilo Villaverde pour écrire ’La Loma del Angel’ (la Colline de l’Ange), un des regards les plus acides et impitoyables de l’histoire de Cuba. Il parcourait La Havane, de jour à la recherche d’insaisissables nourritures, et de nuit dans l’espoir de trouver quelque amour furtif. De la jetée, il voulait que ses cendres fussent dispersées pour que de beaux adolescents à moitié nus, comme des dieux ou des éphèbes grecs, serrés par les bras de l’écume des vagues, plongeassent en elles.
Il insista pour que je photocopie toutes mes notes, poèmes et manuscrits de mon séjour en Suisse et en Italie, en même temps que je répondais aux invitations de l’Université de Fribourg et de Neuchâtel. Il me lut des passages du livre de ses mémoires ’Antes que anochezca’ (Avant la nuit) qui venait d’être publié à Paris. Je fus ému par le passage de la rencontre avec d’autres écrivains cubains qui – comme des fonctionnaires – firent obstacle à sa carrière et rendirent insupportable sa vie dans l’île. Rei renoua contact avec eux et leur pardonna. Sa pitié effaça tout vestige de haine.
Il recommença à me parler des photocopies et des manuscrits. Il devenait complètement paranoïaque, car plusieurs de ses textes n’ont jamais été retrouvés. Chaque fois qu’il finissait un texte, il le reproduisait et le distribuait à ses amis. Je lui promis de le faire. Et le fis. Peu de temps après, je retournai à La Havane. Soumis à un rigoureux examen par la police à l’aéroport de Cuba, je fus interrogé et arrêté. On me déshabilla. Ils retrouvèrent l’adresse d’Arenas, Gastón Baquero, Eugenio Florit et d’autres écrivains cubains en exil. Il fouillèrent dans mon journal. Le policier de la douane, transformé en un lecteur attentif, avait la preuve que j’avais parlé avec Reinaldo. À partir de ce moment-là, il fut particulièrement brutal. Ils ne trouvèrent que quelque argent (en dollars), apporté de Suisse, destiné au peintre cubain Manero, déjà très malade d’une tumeur cancéreuse à la tête, de laquelle, plus tard, il décéda.
Cet argent me fit avoir un procès et je dus payer une amende. L’argent fut confisqué. Mes manuscrits aussi.
Quand tu iras à Florence, écris nos noms sur un mur quelconque, fut son dernier vœu. Sa vie a été un chaos dévastateur dans la soif des passions, comme s’il avait été un personnage de plus de son roman ’El mundo alucinante’ (Le monde hallucinant), qui reçut à Paris le Prix Médicis du meilleur roman étranger alors qu’il vivait à Cuba comme un mendiant. Il avait horreur de vieillir. Du suicide, il parlait toujours comme une fin préférée. Paroles prémonitoires. Son mépris pour la vie était en même temps une manière de l’aimer et de se moquer de la mort.
Avant de retourner à La Havane, je lui fis parvenir, depuis la Suisse, une photo du peintre Clara Morera et de moi, auprès de notre amie Françine Rosenbaum qu’il baptisa ’la fée helvétique’. Avec les photos, je lui postai deux poèmes que je lui dédiais dans deux recueils inédits. ’Conversaciones con Rimbaud’ (Conversations avec Rimbaud) et ’Palabras en el desierto' (Mots dans le désert). S’il aimait ces poèmes, il devait me téléphoner chez Francine où je me trouvais dans un vieux moulin plein de charme et de mystère, en plein milieu de la campagne italienne ravagée par la sécheresse, près d’Andora.
La sonnette du téléphone devait sonner trois fois. Je fixai une heure et un jour.
La maladie qui le minait progressait inexorablement. Au moment convenu du rendez-vous, le téléphone sonna. Trois longs coups dans le petit matin de la campagne, inondé par le chant des grillons, l’océan d’étoiles et la douce et apaisante respiration de l’amie qui dormait non loin de moi. Je n’ai pas décroché le téléphone, pour ne pas dire au revoir. J’ai toujours l’espoir de le rencontrer un jour.
Alberto Lauro
textes originaux inédits écrits en Espagnol-Cuba, traduit par Orlando Alomá
* en français dans le texte
** ndr : in ’Termina el desfile’ (Fin de défilé)
***