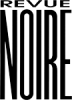Jean-Claude Charles est né en 1949 à Port-au-Prince, Haïti, décédé à Paris en 2008. Écrivain, il est également scénariste et collabore au quotidien le Monde où il écrit des récits de voyage. Il a participé aux éditions du magazine Revue Noire RN06-09 sur les Caraïbes.
Oeuvres : ' Le corps noir', Ed Hachette POL (1980), 'De si jolies petites plages', Ed Stock (1982), 'Bamboola Bamboche', Ed Barrault (1984), 'Manhattan Blues', Ed Barrault (1984), 'Ferdinand, je suis à Paris', Ed Barrault (1987), 'L’Odeur des putois dans la forêt', (1993).
***
En ces terres d’enfance caraïbes
[textes de Jean-Claude Charles écrits pour Revue Noire
publiés dans RN 06 et RN 09 en septembre 1992, textes inédits originaux en français]
1 – Aux bals de l’archipel
En ces terres d’enfance caraïbes, entre l’allègre et injuste Cuba de Batista et l’île de la justice sociale dérivant vers le fer intolérable du « Barbu » devenu vieux, dans un monde où s’écroulent les idéaux messianiques, ce ne fut pas d’abord des images, mais des sons que nous vint la révélation de notre communauté d’histoire. Aux bals de l’archipel, résonnait ce qu’en créole, quelles qu’en soient les variations, on appelait uniformément le Tipiko, les musiques de Cuba, et ce nom bi-syllabique à lui seul nous faisait rêver. Les images vinrent plus tard : elles furent d’abord de la photographie, puis de la télévision. Certes il y avait Wifredo Lam, mais la « peinture étrangère » hein ? Dans un pays où l’inflation des images locales bouchait à peu près tout le paysage extérieur. Tandis qu’un dictateur fou à lunettes et chapeau de Baron Samedi mettait en pièces les corps et les âmes, affolant les anglo-cartésiens de Washington, fascinant l’Ethiopien Hailé Sélassié jusqu’à pousser ce dernier à accomplir un voyage en pays de ressemblance, nous fûmes nombreux à fantasmer un réveil historique sur les apparitions des héros de la Sierra Maestra. Et là encore, dominance des sons : des postes à galène aux gros appareils américains qu’on regardait en écoutant, quelques-uns (gag) tapant parfois derrière pour voir s'il y avait quelqu’un. Puis, chez certains privilégiés, la télévision donc. Pour moi, la littérature vint plus tard : Nicolás Guillén, Guillermo Cabrera Infante... Plus tard encore, le sculpteur Cardenas. Et les écrivains José Lezama Lima, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas...
2 – Caraïbes - Les flics de l’identité
Je me suis souvent demandé pourquoi les Caraïbes de colonisation anglaise n'avaient rien engendré de comparable à la Santèría de Cuba, au Vodou d'Haïti, au candomblé du Brésil. Tous cultes importés d'Afrique, réadaptés sur place. (Bien sûr, "réadaptation" n'est pas le concept juste.) A creuser - comme on dit bizarrement - la question de l'identité caraïbe, on ne peut contourner cette dissemblance. Que la Jamaïque ait produit le mouvement Rasta n'a rien à voir. Et quelle signification faut-il donner au fait que Cuba (anciennement colonisé par les Espagnols), Haïti (par les Français), le Brésil (par les Portugais) dessinent la figure des trois casse-tête politiques modernes: la révolution, la dictature, le capitalisme ?
Et que diable vient chercher le Brésil là-dedans ? L' écrivain René Depestre soutenait que ce pays fait partie de "la grande Caraïbe". L'universitaire qui le souligne nous envoie une intéressante étude sur Juan Bobo, Jan Sòt, Ti Jan et Bad John (*), figures mythiques de Cuba, Porto Rico, Haïti, les Antilles dites "petites", qui trouvent un traitement renouvelé, singulièrement riche dans la modernité, et leur alter ego dans le personnage brésilien de Pedro Malasarte. Rappel, s'il en était besoin, de l'existence d'une identité caraïbe, certes hétérogène, plurielle, complexe, mais cohérente, vivante.
Cette identité, plus ou moins stable, plus ou moins altérable, n'est saisissable ni en termes de stricte proximité géo-maritime, le 'kolé-séré' de ce qu'on nomme "les îles", ni en termes bêtement administratifs: "Vos papiers s'il vous plaît?" De la Louisiane et la Floride, vers la Guyane, le parcours culturel est à la fois hasardeux et rigoureux, les glissements vers la côte continentale, vers le Brésil, aussi logiques que fous, jamais flous. Et qu'ont à faire les peuples qui migrent avec les questions des douaniers de l'identité, les calculs d'appareils, les rondes de surveillance des garde-côtes, les interrogatoires d'officiers d'immigration? Rien.
Encore moins les créateurs. Ils sont dans le débordement: de l'origine, du trajet biographique, des histoires nationales. Jean-Michel Basquiat, New-Yorkais de Brooklyn monté à Manhattan, originaire d'Haïti et de Porto-Rico, mort plus tôt qu'à son tour, vivant d'avoir peint son éternité sur toutes surfaces praticables, est là pour le prouver. Il suffit d'ouvrir les yeux sur ses images.
De même, dans le paysage du cinéma de cette fin de siècle, Raoul Peck, cet ancien chauffeur de taxi new-yorkais, né à Port-au-Prince, émigré jeune au Zaïre et en France, basé à Berlin, retourné à Paris, aux dernières nouvelles il tournait à Saint-Domingue, nomade céleste, traversant les pays sur le mode de ce que Godard disait du cinéma, à savoir qu'un film ça ne sera jamais qu'un plan après un autre plan, réinventant avec Haitian Corner la ville où le pays le plus riche du monde rencontre le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, cette mégalopole dingue accrochée à l'Atlantique, miroir où toutes sortes d'alouettes blessées viennent se cogner encore: Nouyòk, Nueva-York...
Les flics de l'identité vont être excédés : ça circule de partout, par nécessité et... "pour de rire"! Ce n'est pas autre chose que disaient Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, s'aventurant dans une prospective que seuls ceux qui ne font pas attention à la circulation des hommes et des idées aujourd'hui trouveront excessive, dans leur Eloge de la créolité: "Le fils né et vivant à Pékin, d'un Allemand ayant épousé une Haïtienne, sera écartelé entre plusieurs langues, plusieurs histoires, pris dans l'ambiguïté torrentielle d'une identité mosaïque. Il devra, sous peine de mort créative, la penser dans toute sa complexité". (**)
Arts visuels et littératures témoignent déjà de cette réalité. Où classer Kamau Brathwaite ? A la Jamaïque où il vit et à laquelle est liée son image courante ou bien aux Barbades dont il est originaire et qu'il porte nécessairement en lui ? Le phénomène de dispersion ira sûrement en s'accentuant et, avec elle, naîtront des livres, des images sans nationalité, portés par des traversées, des passages, des coulées de signes sans passeport, des métaphores de chiens perdus sans collier dans le bruit et la fureur du monde et se retrouvent cependant dans des choix de créateurs à la fois butés et ouverts à l'aventure d'une nouvelle humanité.
(*) Juan Bobo, Jan Sòt, Ti Jan et Bad John, par Maxilien Laroche, H. Nigel Thomas, Euridice Figueiredo, éd. Grelca, Université Laval, Québec, 1991.
(**) Eloge de la créolité, par Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Gallimard, 1989.
3 – Recherchons Mathilde, 26 ans
Face aux chiffres qui giflent. Que le monde se renvoie à la tête. Il y a des personnages qui disparaissent pour ne plus jamais réapparaître.
Recherchons Mathilde, 26 ans, taille moyenne, crinière de lionne frisée, plutôt enrobée, plutôt belle, oui, vous ne l’auriez pas aperçue ? Derrière le fléau, il y a le surgissement des choses mal vues, mal dites. La pluie des clichés : ainsi les marines américains auraient introduit l’homosexualité et le virus en Haïti exactement en 1915 – dit de Papa.
Avant cette date, les 'Masisi' * n’existaient pas. Quel intellectuel osera se coltiner la recherche du temps perdu de nos sociétés esclavagistes ?
Certaines pratiques du vaudou ? La peur de la honte à boire face au travail abject de culpabilisation des Nègres par les idéologues planqués derrière le voile de la Science finit par atteindre nos consciences. Ainsi n’ose-t-on évoquer une bisexualité répandues dans les Caraïbes.
La morale, faute de pouvoir s’investir en politique ou dans la justice sociale, file vers les abysses où se cache le Diable depuis toujours. Il n’y a guère que les artistes pour ne pas se laisser intimider.
Enfin, beaucoup, pas tous. Souvent l’humour s’en mêler : le peintre Télémaque donne pour titre à une oeuvre sur le SIDA : ’Import-Export’. Cela me fait penser à un bordel coincé entre la mer et un laboratoire d’analyses médicales, sous les cocotiers que narguait la rumeur populaire, j’y ai entendu raconter que… ”même les cocotiers ont le SIDA”.
C’était non loin d’un lieu à l’enseigne surprenante : ’Désir de Dieu’.
* 'Masisi' signifie pédé, en créole
4 – ”Je n’ai jamais joué avec mon père”
Je me souviens des femmes, avec ou sans madras, avec ou sans foulard, campées depuis la nuit de l'esclavage et de la colonisation, au mitan des jours, au mitan des nuits, dressées dans une obstinée surdité à tout ce qui nous niait. Ou dans le semblant des yeux baissés. Ou bien autrement... À distance respectable d'une Europe qui, à travers Engels, Wilhelm Reich et d'autres, aura développé une virulente critique anti-familialiste ; à travers les idéologues des années soixante et soixante-dix, aura appris que des institutions comme l'école, les églises, etc. sont des "cellules de reproduction idéologiques"... Derrière chaque créateur des Caraïbes, il y a une mère à laquelle, pour le meilleur et pour le pire, personne n'a jamais pensé à résister. Les métissages sont passés par elle, les langues ("maternelles", les bien nommées), les jeux... Quant aux hommes, ils bivouaquèrent sur d'autres champs : de bataille, de canne à sucre, au mitan de silences ou de parleries vaines, de sentiments d'humiliation ou d'arrogances, protégeant parfois les leurs par une présence oblique, des chemins de traverse, en prison ou massacreurs, gueux ou fabricants de gueux, ou bien tentant de réinventer l'absence. Un ami me dit: « Je n'ai jamais joué avec mon père ». Mots courants dans la bouche des pères: « Va donc demander à ta mère »... Je ne prétends pas que tout fut ainsi partout. Je dis que cela régna.
5 – Lettre à Vincent et aux autres
On part de Berlin. On part de Paris, pour aller à Fort-de-France. On y reste quelques jours. On rencontre des personnages passionnants. A la Martinique, j’ai parlé d’écriture, de cinéma, d’amours. Et je me suis souvenu que Schœlcher était au Panthéon. Nous étions nombreux à mériter d’être au Panthéon, disais-je. “Encore faut-il que ça soit une bonne affaire”, a lancé quelqu’un en rigolant. Jours et nuits, nous avons parlé.
On tient un journal de bord.
L’ homme qui a vu. À lui, désormais, de raconter ce qu’il a vu. Je me me contente d’être un relais. Chaque homme ou femme des Caraïbes devrait avoir le courage de dire une chose simple: je ne partirai pas de ce monde sans avoir tenté d’éclaircir une ou deux affaires apparemment mystérieuses.
Rencontres de jour, non loin de la Savane, avec Patrick Chamoiseau, à cette librairie où je signais mes livres; avec Suzy Landau, à l’initiative du festival de cinéma Images Caraïbes, dont le premier lauréat fut mon ami de Berlin, Raoul Peck. Sans parler du libraire, Philippe Vallée, bonhomme sorti tout droit d’un film de Woody Allen, goûteur d’encres.
Mais, à parler de ceux qui ont un nom, on risque d’oublier les anonymes. Par tempérament, j’aime beaucoup ces gens dont Césaire se disait “la bouche”. Si ma mémoire est bonne: “Je suis la bouche de ceux qui n’ont point de bouche”...
Rencontres de nuit. Je me souviens de ces vagabonds qui, vus de loin, se racontaient des histoires: l’un d’eux a fait le geste de tirer du pied une balle au but, j’ai cru que c’était la reconstitution d’un match de foot. Eh bien non, m’étant approché, c’était l’histoire d’une scène sexuelle: le pied du type était un sexe, le ballon Dieu sait quoi, en tout cas c’était un but. (Plus tard, me baladant avec Xavier Orville dans les rues de Stuttgart, on se marrait sur cette manière de raconter.)
Il y eut aussi les rendez-vous manqués. Avec Vincent Placoly : lui m’attendant dans le hall de l’hôtel, La Batelière, moi attendant son appel - je lui avais dit que je travaillerais dans ma chambre jusqu’à ce que qu’il soit là, en bas, de m’appeler alors, je descendrais tout de suite, nous devions prendre le petit déjeuner ensemble; une des ces histoires absurdes d’écrivains intimidés l’un par l’autre, ou distraits... Où que tu sois, Vincent, en haut ou en bas, au paradis ou nulle part, salut !
Je m’aperçois que je mélange deux voyages différents.
Autant citer Césaire: “Au bout du petit matin... Va-t-en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t-en je déteste les larbins de l’ordre et les hannetons de l’espérance. Va-t-en mauvais 'gri-gri', punaise de moinillon”. La première page du Cahier, quand on la relit, conduit toujours à la dernière: “... la langue maléfique de la nuit”... Impossible de s’arrêter à un seul mot, on va toujours vers la suite, vers le reste, vers la fin. Un demi-siècle après (la première version parut en 1939, à Paris, dans la revue Volontés), Cahier d’un retour au pays natal me sauve la vie.
Ces pensées me venaient, dans l’air chaud, comme je marchais autour de la Savane : dès mon premier jour à la Martinique, j’aimai m’y balader. Chez Gaston, l’unique restaurant ouvert dans la ville après une certaine heure, est une bénédiction. De la littérature au rhum, change-t-on vraiment de sujet ?
6 – La vie comme ça JAZZ
Quand la place de l'esclave changea, dans ce changement aura joué un facteur essentiel : la relation traditionnelle des sociétés africaines avec la mort. Cette relation, les esclaves arrachés à leur sol l'avaient gardée. Elle n'appartenait pas à une ethnie en particulier, ni à l'Afrique perçue à travers la fantasmatique mise en branle par la production littéraire, les chroniques de voyageurs, les témoignages des navigateurs (lieu vague, flou, donnant prise à une narration globalisante, espace sans histoire, sans ancrage pluralisé, lieu étrange et étranger). Faite de respect d'un ordre du monde où l'individu et ses ancêtres, leur terre et les puissances célestes, participent d'un tout harmonieux, elle fut tout autant, sous des formes diversifiées, Yoruba (Nigéria, Bénin) que Congo (Zaïre, Congo, Angola) ou Mandingue (Mali, Guinée, Sénégal). Élaborée dans le continent noir, transférée dans les Amériques, cette relation avec la mort subira des transformations déterminées par les histoires spécifiques des formations sociales. Au-delà d'elle, c'est tout l'édifice imaginaire qui est en question. Il donne la mesure d'une ré-appropriation active des mythes. Il ne faut pas entendre autrement les formes de lutte des esclaves : du suicide ( « pour retourner en Guinée ») aux assauts guerriers qui impressionnèrent tellement les armées françaises à Saint-Domingue ( « les boulets sont de la poussière »). Des temps du spiritual et du blues au jazz moderne, les mythologies noires résonnent de ce double travail de mémoire et d'invention : « The hammers keep ringing on somebody's coffin… / The hearse wheels ringing on somebody's graveyard… » (Les marteaux résonnent encore sur le cercueil d'un mort ./ Les roues du corbillard résonnent encore dans un cimetière).
Il y a, dans le Gwo'Ka en Guadeloupe, le même acharnement à se colleter, d'un même mouvement, à la vie et à la mort. Écouter voir un soir Guy Konkèt secouer. Gro'Ka. Masse d'histoires remuées. Les performances de Konkèt tiennent toujours de l'insurrection esthétique. L’homme est saisi par la rigueur de sept rythmes : mindé, tumblak, léroz, kaladja, roulé, graj et padjembel. Et la vie comme ça jazz. Musique rurale collée au quotidien urbain sans que jamais le mythe soit loin : « Pot-la té femin ».(La porte était fermée / Comment diable es-tu rentré ?). Comme dit Jean Vautrin, « une musique à répondre ». Musique d'humour et de défi ; mais aussi d'élan, d'extrême tendresse. À la fois la guerre et la paix, aime à dire Guy Konkèt, fils d'attacheuse de canne à sucre en Guadeloupe. Il maintient vivante une tradition interdite à l'époque de l'esclavage et bivouaque dans l'avenir : au dialogue séculaire entre le boula (tambour rythmique), et le maké (tambour soliste), Konkèt ajoute une batterie, un piano, une guitare basse, ce qu'il veut, c'est lui le chef. Et comme la Guadeloupe n'est pas seule à rêver de changer de rêve, il voyage volontiers du côté d'Haïti pour le répertoire et des Noirs-Américains pour quelques sonorités, refusant de remplacer « Doudou » par « Camarade », de balancer des slogans, des programmes. Si cette musique est de révolte, c'est dans son énergie même. Quand la détresse devient sentiment créateur. L’énergie joyeuse du désespoir qui vous requinque vite fait : « un Ka, c'est un ka, ça n'est pas autre chose ».
7 – Diaspora
« Des nègres attroupés et soulevés se doivent dissiper sur le champ à coups de bâtons et de nerfs de bœufs »... Xavier de Charlevoix, Saint-Domingue, 1731
Plus tard, en 1764, « le Ministre ayant été informé des désordres qu’occasionnait en France le grand nombre de Nègres et de Mulâtres qui s’y accroit tous les jours, il leur a été ordonné à tous indistinctement de repasser dans les colonies d’où ils sont sortis »... Gazette de Saint-Domingue.
Vers la fin du siècle suivant, voici que toujours ils s’attroupent, se soulèvent : « Le soir, en se promenant dans la campagne, on pouvait entendre les cris joyeux qu’ils poussaient en se livrant à quelques quadrilles désordonnés et les sons discordants de leur orchestre »...
Un siècle plus tard, à Paris, à Londres ou à minuit, un peu partout dans la ville, en ces lieux flagellés de néons ou mauves, ajustez la vue, l’oreille, ils s’attroupent, se soulèvent, et le public applaudit.
8 – Blues
Voilà l'alphabet de nos amours
d'autres adviendront
jamais décomposées
il n'y aura jamais assez d'espace
pour nos amours
Il y a aussi les assassinats
je me souviendrai toujours des assassinats
je me souviens de l'assassinat de
Michael Smith dans un cimetière
à Kingston lapidé
imaginez paix à ma bouche
imaginez Mutabaruka lapidé
L'Afrique au commencement
était l'Afrique
cela ne veut nullement dire
retour à
l'Origine mythique
voici la croix de ton père
voici la croix de la mère
J'ai vu les boat-people
de Cuba
d'Haïti
j'ai vu errer
entre les Bahamas Porto-Rico Miami
j'ai vu errer des chiens
enfants de la Révolution et de la Dictature
pousser fleurs sur le fumier
de l'Amérique et autres fumiers
Un jour j'ai vu les Caraïbes
en Côte d'Ivoire
en pays agni
à Bettié
au bord du fleuve
J'ai vu Basquiat
couché sur le gazon
face vers ciel
portrait de Basquiat en homme heureux
J'ai vu des coups d'Etat
en Haïti
à Grenade
des invasions
pas envie de parler
de coups d'Etat
d'invasions
À parler de créolité
on pléonasme
un jour quelqu'un m'a dit
que j'étais un écrivain naïf
naïf mon cul
Le modèle du capitalisme
est au Brésil
y a-t-il des questions?
Un jour
j'ai rêvé d'élever des cochons
J'ai rêvé d'être Henri Christophe
monarque attaché
aux rites du Maître
d'être Dessalines proclamé Empereur
Traverser la nuit de la servitude
Tout créateur caraïbe sait
bien
qu'il y a un jour où la main tremble
tirer un trait à la main
devient pénible l'enfer
un jour vient
le trait d'une rectitude céleste
Qu'apprend l'exil?
Qu'un enfant une femme un homme
et tant pis si l'ordre est convenu
capable d'abandonner son pays
est d'une force redoutable
Je me souviens que le Suisse Max Frisch
disait:
"Est-ce qu'on a une patrie seulement quand on l'aime?
Et si elle ne vous aime pas?"
Mon ami Frankétienne
raconte des histoires tordues
il dit
que ce pays est foutu
il le dit et il est là
ici
dans ce pays
Mon ami Michael Dash
tourne sept fois sa langue
dans sa bouche pour
dire
je suis Jamaïcain
je suis Haïtien
je suis Trinidadien
je suis de Londres
à la fin je ne sais plus
Mon ami Télémaque
ah faut-il parler
de Télémaque?
Quant à Basquiat
le mort qui revient
les morts reviennent toujours hey
9 – Jeu d’osselets
Pour Jo
quoi faire
avec six
rotules de cabris
d’ailleurs sont-ce
tes rotules
p’tit cabri
avec sept
osselets
qu’en l’air
on lançait
où diable six
convexe la face
concave la face
hé toi
farce toi-même
allons te vexe pas
cave de cabri
où donc six
allez face en S
face en I
t’manque un X
hé p’tite garce
(poème Kazoo hé)
10 – Fleuves et rivières
Vous quittez
votre rivière
vous quittez
votre fleuve
vous partez
sur la route
plein de gens
vous posent
toutes sortes de
questions
monsieur
que faites-vous
dans la vie
je suis marié
à une rivière
madame
que faites-vous
dans la vie
je suis mariée
à un fleuve
11 – Dans sa maison de Delmas, Frankétienne a le blues
D’emblée, il nous parle d’Haïti comme étant ce qu’on appelle en créole un Kalfou Tintin. Un non-lieu, l’endroit où l’on tourne sans issue, sans savoir où l’on va, d’où l’on vient, l’heure qu’il est ou qu’il n’est pas.
Pour l’écrivain, une vieille affaire. Elle remonte à l’indépendance : « Depuis 1804, nous tenons un bout du tissu, une pelote de fil, avec une aiguille sans chas, et nous essayons de broder avec ce piège. Nous sommes enfermés dans un ghetto, du fait de l’impuissance historique de nos élites qui se sont mises à imiter les anciens colonisateurs après les avoir chassés. Comment gravir une échelle à l’envers ? On a repris le français, la religion catholique, en mettant de côté la tradition, alors qu’il fallait un dosage équilibré. Il y a eu cette coupure, qui demeure : d’un côté, une masse portée par une culture à base africaine, portée par le vodou, dans un territoire mythique ; de l’autre, une élite exclusivement branchée sur un Occident irréel, prisonnière d’un mimétisme stérile, incapable de gérer le pays. Le grand échec de la France, ce n’est pas d’avoir perdu la guerre contre les forces indigènes à la fin du 18e siècle, ça n’est qu’un échec militaire, ça arrive toujours, mais c’est d’avoir préféré miser sur cette élite parasitaire, laquelle maintenant se trouve vers les Etats-Unis ».
L’homme, également peintre, s’anime à l’évocation du « formidable souffle créateur en Haïti » : les 30 000 peintres et 40 000 artisans de ce pays, d’après ses estimations.... » Ce peuple merveilleux, j’ai appris à le respecter, on a tout fait pour lui briser les reins, il a survécu grâce à la création ».
D’un texte en cours, son « testament », assure-t-il, Frankétienne lit ceci :
« Le vieux singe a mûri à l’intérieur du cirque ».
On a le temps, entre New York et Port-au-Prince, dans le Boeing qui relie en trois heures et demie les deux villes, parmi les enfants les plus endimanchés et les plus sages vus de mémoire de voyageur, dans le ciel ensoleillé à mesure, jusqu’à la danse des lourdes valises par 40 degrés à l’ombre, les mots criés, les retrouvailles, les embrassements, on a le temps de se préparer au choc de Delmas.
Hier encore, le chef des tontons-macoutes avait choisi d’installer ici son quartier général et, de là, partait à la reconquête de son pouvoir perdu, son Oungan (prêtre vodou) l’ayant dit-on assuré que ce serait son jour de gloire, le baroud sans honneur se terminant en farce sinistre, l’homme et ses acolytes ont été capturés, embastillés, jugés à la va-vite, et tout est rentré dans un ordre provisoire.
Aujourd’hui, Delmas ressemble à Delmas, canicule et poussière, la circulation folle, la mer derrière nous à l’ouest, et à l’est la montagne s’avançant vers nous, vers l’amas de ferraille roulant qu’un type à l’aéroport nous avait présenté comme son taxi, il n’y avait aucune raison de ne pas croire, puisque ça roule.
Pétionville. Passé quelques rues, dans cette allée bordée d’arbres et de murs en pierre venues de carrières proches, tout est calme. Au bord de piscine de l’hôtel, où nagent trois sirènes, le premier rhum est un rite nécessaire, une cérémonie qu’on renouvelle sans se presser, en clignant les paupières sous le soleil, jusqu’à ce que celui-ci disparaisse derrière de gros nuages couleur aluminium.
On regagne la chambre en se disant qu’il faut vite se mettre au travail, allez. On travaille debout, sans stylo, accoudé à la balustrade de la villa, les yeux ouverts sur des promesses d’éclairs, de foudre, le vent gifle des massifs d’hibiscus, les masses écarlates des flamboyants ploient sous la pluie, un déluge comme un seul ce pays en a le secret. La nuit, entre deux rêves paisibles, on se rappelle qu’il a fallu attendre vingt ans, une éternité, pour goûter l’orage de ce premier jour.
Au sud de Port-au-Prince, le quartier « chaud » de Martissant. Les lieux ont des noms surprenants : Désir de Dieu.
Au Caribeño/bordel qui s’étend entre un laboratoire d’analyses médicales et la mer, c’est en vain que nous recherchons Mathilde, 26 ans, taille moyenne, crinière de lionne frisée, plutôt enrobée, plutôt belle, oui, vous ne l’auriez aperçue ? Non, non, son ami Harry, 23 ans, ne sait pas où elle est passée.
Un père sergent retraité de l’armée dominicaine, une mère tenant une échoppe quelque part dans la banlieue de santo Domingo, quatre frères, Mathilde gagnait ici la vie de sa famille.
Le conflit séculaire entre Haïtiens et Dominicains retrouve une désolante actualité. L’heure est à la chasse aux Haïtiens en République dominicaine. Et comme dans toute situation de crise, le débat ne vole pas toujours très haut.
Aujourd’hui, « le virus » sert parfois de balle de ping-pong commode. Or la réalité est autrement têtue. Et, communauté d’histoire oblige, complexe. De la frontière entre les deux républiques qui se partagent l’île, Mathilde ne savait plus très bien à quel côté elle appartenait. Son ami Harry non plus.
Au bord de la mer, sous les cocotiers que nargue la rumeur populaire (« même les cocotiers ont le sida », dit-p,), sous la tonnelle qui tient lieu de bar dansant, pensionnaires et clients du Carabeño reprennent en chœur avec un chanteur hispanophone un « bolero-sirop », une de ces romances à succès où les mots jouent à ne pas désigner ce qu’ils désignent.
À un hôtel de luxe, réussi le tour de force de déjeuner la vigilance des services de sécurité autour de Jimmy Carter.
À la suite de quoi je me retrouve à déjeuner à une table voisine de l’ex-président des USA, sous le regard faussement indifférent de gardes du corps baraqués.
On s’amuse comme on peut.
Le soir est plus agréable, le monde plus fou, et au plus noir de la nuit, à ciel ouvert, sous la pleine lune, parmi une assemblée de poètes, chez l’écrivain Lyonel Trouillot qui écrit en créole des choses que nous traduisons :
« Amis des mauvais jours/ l’orage a vaincu la lune/ un long cheveu blanc pousse à la tête de mes rêves/ la terre d’ici, à peine le soleil bat-il des paupières, son jour payé, voici que la nuit l’endette »... Le texte est un hommage aux Anges de l’eau.
Loin du bruit et de la fureur de la ville basse, sur les hauteurs de Kenscoff, là où les va-nu-pieds assiègent les millionnaires, comme d’ailleurs partout dans ce pays, une soirée chez les gens « condamnés » à vivre avec les derniers comme avec les premiers, une soirée « sympathique » dans l’atmosphère du roman Les Comédiens de Graham Greene (1966) : « Le soir, quand vous entendrez des coups de feu »...
C’était dans les années soixante et Papa Doc détestait ça. Un romancier, de surcroît étranger, avait vu : « (...) l’île vers laquelle nous nous dirigions avait cessé d’attirer les touristes ». Et aussi : « Ce n’est plus ce qu’on appelle le paradis du touriste ? - Non. En fait ça ne l’a jamais été. - Mais sans doute cela offre-t-il quelques possibilités à un homme d’imagination ? - Cela dépend. De quoi ? - Du genre de scrupules que vous avez. - Des scrupules ? (...) Oh ! bien, ajouta-t-il, les scrupules... coûtent cher...»
Graham Greene que Papa Doc détestait (l’écrivain comme le livre).
Cap, dans le nord d’Haïti, la Citadelle que Césaire dans la tragédie du Roi Christophe décrivait ainsi, donnant la parole au monarque noir du début du XIXen un des pères fondateurs de l’Indépendance : « Voyez, sa tête est dans les nuages, ses pieds creusent l’abîme, ses bouches crachent la mitraille jusqu’au large des mers, jusqu’au fond des vallées, c’est une ville, une forteresse, un lourd cuirassé de pierre »... Et où le Cubain Alejo Carpentier, dans une de ses Chroniques, voyait un « ouvrage sans antécédents architecturaux, uniquement annoncé par les Prisons imaginaires du Piranèse »...
Combien de kilomètres avions-nous faits ?
Le dictateur aurait été furieux, lui qui aimait si peu que les gens circulent dans son pays. Faut-il compter de Paris ou de New York ? Ou de cette route de Delmas que son fils, fortune faite, dut emprunter dans le mauvais sens (vers l’aéroport de la capitale) pour s’exiler en France ?
12 – Nation Noire
Vite la place de l’esclave va changer. Je suis d’avis que, dans ce changement, aura joué un facteur essentiel : la relation traditionnelle des sociétés africaines avec la mort. Cette relation, les esclaves arrachés à leur sol vont la garder. Elle n’appartient pas à une ethnie en particulier, ni à l’Afrique perçue à travers la fantasmatique mise en branle par la production littéraire, les chroniques de voyageurs, les témoignages des navigateurs (lieu vague, flou, donnant prise à une narration globalisante, espace sans histoire, sans ancrage pluralisé, lieu étrange et étranger). Faite de respect d’un ordre du monde où l’individu et ses ancêtres, leur terre et les puissances célestes, participent d’un tout harmonieux, elle est tout autant, sous des formes diversifiées, Yoruba (Nigeria, Bénin) que Congo (Zaïre, Congo, Angola) ou mandingue (Mali, Guinée, Sénégal). Elaborée dans le continent noir, transférée dans les Amériques, cette relation avec la mort subira des transformations déterminées par les histoires spécifiques des formations sociales. Au-delà d’elle, c’est tout l’édifice imaginaire qui est en question. Il donne la mesure d’une ré-appropriation active des mythes. Il ne faut pas entendre autrement les formes de lutte des esclaves : du suicide (« pour retourner en Guinée ») aux assauts guerriers qui impressionnèrent tellement les armées françaises à Saint-Domingue (« les boulets sont de la poussière »). Des temps du spiritual et du blues au jazz moderne, les mythologies noires résonnent de ce travail de mémoire et d’invention : « The hammers keep ringing on somebody’s graveyard » (Les marteaux résonnent encore sur le cercueil d’un mort.../ Les roues du corbillard résonnent encore dans un cimetière).
Au commencement était l’Afrique. Non pas une entité homogène, sans clivages, idéale, mais un continent de diversités, avec des sociétés hiérarchisées, des valeurs de civilisation dynamiques et des éléments d’inertie. Sur cette terre, la traite négrière va opérer du XVe au XIXe siècle une ponction humaine aux caractéristiques différentes de l’émigration des Européens vers ce qu’on appela le « Nouveau Monde ». L’émigration des Européens - certes provoquée par des contingences socio-économiques - reste volontaire, est exactement mesurable, localisable en ses lieux de départ et d’arrivée. Alors que le déplacement des Africains, porté par l’extrême contrainte, est au sens propre déracinement ; entretenu par la violence coloniale, transplantation ; mesurable avec imprécision (les estimations des pertes subies par le continent noir varient entre une vingtaine et deux centaine de millions d’être humains) ; à l’image des bouleversements survenus alors aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil.
Ces différences en induisent d’autres sur le plan de la formation et des composantes particulières des mythologies. Alors que la démarche des immigrants espagnols, portugais, anglais, français dans les Amériques sera celle d’une « oublieuse mémoire », les portant à en découdre avec le « Vieux Monde », le geste des esclaves sera de préservation des origines, l’Afrique, venus souvent de plus loin, des terres intérieures, au terme de mouvements de population où la demande de main-d’œuvre en Occident jouera un rôle croissant, rien ne les aura préparés au choc de leur nouvelle condition. Là où les Européens vont inventer, les Africains, dans un premier temps, vont conserver. Il y aura simple transfert de mythes, repérables dans la parole des maîtres, les seules sources anciennes à ce stade où, par ailleurs, l’extraordinaire mobilité du trafic servile autorisé à confronter les observations consignées à partir de plusieurs colonies des Amériques. La place de l’esclave est alors définie, au-delà des dissemblances entre ces colonies américaines, par les besoins de l’économie de plantation. On pourrait ici parler des premiers âges d’Haïti, alors appelée Saint-Domingue, d’un terme de maître.
Jean-Claude Charles
***
Le navire des ancêtre en flammes
– mais cette Caraïbe, elle est si bourrée de morts
que lorsque je me mêlais à l’eau émeraude
dont la voute ondoyait comme une tente de soie,
je voyais ces coraux : cerveau, feu, gorgoness,
doigts-d’hommes-morts, et c’étaient les hommes morts.
Derek Walcott, ’The shooter Flight’
1
Ça serait une histoire où se mêleraient des combats de coqs, sur des images de vierges offensées dans des cavernes de voleurs, offrandes à des dieux incertains, entre fleuves et forêts, sous des volcans mal éteints, des ciels bleus avec dentelles de nuages gros de cyclones ravageurs, et des tendresses désarmantes, sur des airs de boléro s'élevant de vérandas cachées derrière les massifs d'hibiscus, dans des parfums de lilas et de jasmin rue Concordia, à Ponce, et des colères indomptables, des retours de mémoire, de singuliers oublis, et l'on pourrait parler ainsi, longtemps, jusqu'à ce que le jour se lève.
2
Ça serait une histoire, comme si le jour ne se levait pas, avec des dépêches d'agence. Cuba: ’Effondrement économique de l'île d'ici juillet’, assure un document présenté pour confidentiel. Haïti: ’Rien ne va plus’. Jamaïque: ’Le parti national du peuple (au pouvoir) a remporté les élections législatives anticipées d'hier avec 61% des suffrages. De violents affrontements ont eu lieu dans la capitale’... Toile de fond: morne des morts à Kingston, la ville, dit-on depuis toujours, de tous les dangers. Comme si toute ville sans danger n’était pas un malentendu.
3
Ça serait une histoire avec la rhétorique froide des dépêches d'agence, des fragments de récits sortis de manuels scolaires ou de chroniques de voyageurs, ou d'actes notariés, et pleine de drames intimes, de douleurs que compenserait peut-être un profit créateur, peut-être. Révolution, dictature, capitalisme, efforts de démocratisation, avancées, régressions, marche avant, marche arrière, les figures du champ politique de la Caraïbe résisteraient ou ne résisteraient pas au pinceau, au ciseau, à l'objectif, à la phrase. N'importe.
4
Ça serait des choses (appelez-les ’œuvres’, si le coeur vous en dit), une toile, une sculpture, une photographie, un film, un texte. Ces créateurs n'ont pas attendu l'effondrement du bloc de l'est, du mur de Berlin, des idéologies, tout le bazar, pour fabriquer ces choses qui remplissent une fonction élémentaire de respiration, pour eux-mêmes comme pour les autres.
5
Ça serait une histoire simple où tout pourrait arriver, même l'exilé retournant au pays natal, et les canards le matin font un bruit dingue, et les enfants courent après des cerceaux, brandissent des revolvers à eau, lancent en l'air des cerfs-volants, et les adultes roulent dans des autos, courent eux aussi, entre des parenthèses impossibles, après des ballons, portent des bandages sur des blessures qui viennent de trop loin, des histoires de bateaux venus de l'autre bord de la mer, de chevaux, de chaînes amarrées aux chevilles, de boulets traînés, de boulets reçus dans la figure ou traînés, de boulets lancés contre, et il arrive un moment où c'est le rhum qui parle; et lorsque nul ne sait plus si le pays existe, et c'est là que le peuple des peintres, des musiciens, des écrivains intervient pour dire voilà ces terres existent, et en elles, au-delà d'elles, l'honneur singulier de nos formes.
6
Ça serait des récits de rires et de larmes à multiples péripéties, où les langues s’emmêleraient pour démêler l’inextricable. Une histoire bruissante de pépiements d'oiseaux de toutes origines, rossignols du Dahomey, bécasses d'Inde, animaux étranges, tels ces éléphants d'Espagne, crocodiles de la Gaule, dragons d'Angleterre, cigales du Portugal, fourmis du Liban. Et le très bel arbre-Walcott, au Royaume du fruit-étoile, dépliant la carte des Caraïbes, voit en quoi il y a plus d'îles en ce lieu que de pois dans un plat d'étain, de toutes tailles, un millier, ami, rien que dans les Bahamas…*
7
Ça serait une histoire où la Caraïbe trouverait dans l’assemblement des singularités un symbole, où l'on mettrait dans le même navire l’historique et le quotidien, le collectif et l’intime, où l’on négocierait des codes obscurs, des contrats modernes, fomentés comme des complots par les ancêtres. Et où l’on mettrait en flammes le navire des ancêtres.
Jean Claude Charles
[extraits de Derek Walcott in’The shooter Flight’, traduit de l’anglais par Claire Malroux]
***
Tentatives de fugue
Un jour, une fille avait failli m’arracher vraiment les yeux.
J’étais en reportage aux Etats-Unis, sur un sujet dur, les boat-people d’Haïti. Des gens qui avaient commis pour tout crime d’avoir fui une dictature invivable. Les autorités américaines n’avaient trouvé rien de mieux que de les enfermer dans des prisons et des camps. Non pas des camps classiques de réfugiés, mais des enfers de tentes entourées de barbelés, surveillées par des gardes armés, du haut de miradors sortis tout droit de Nuit et brouillard. J’étais résolu à crier au scandale de toutes les forces dont j’étais capable. Je me sentais personnellement humilié.
La journée, j’étais éblouissant d’énergie. Je poussais en cow-boy des portes de bureau, j’accomplissais des miracles au téléphone, je décrochais des rendez-vous impossibles, collectais des informations introuvables.
Le soir, une fois rentré à mon hôtel, face à la mer, le blues s’abattait sur moi. Mon seul remède était de m’installer au bar, avant de sortir dans la nuit comme un chien fou, bourré de whisky, la narine frémissante, la queue fiévreuse, en quête d’aventure insensées.
Dans cette époque frénétique, je garde l’impression d’avoir couché avec au moins une fille par nuit. C’est une impression, pas une vérité statistique. Cela allait du dépannage réciproque jusqu’à la rencontre vénale. Ce n’était pas la première fois que, dans le blues, je m’accrochais aux femmes, il y eut des cas d’amour, les passions brèves et flamboyantes, les reprises de souffle, il y eut surtout le désir effréné, vide d’objet, les corps-à-corps fades, la frustration, la déception, les dérives sensuelles dans la tourmente, les échappés minables d’un être désespérément seul, désespérément semblable à tant d’autres êtres désespérément seuls, jusqu’à la rencontre avec Jenny.
Il y eut, un soir, Peggy, long fruit gorgé de sucre, Peggy émigrée pour un hiver, du froid de l’état de Washington où elle entreprenait des études de journalisme, au soleil de la Floride où elle n’avait pu trouver qu’un job de danseuse nue dans une boîte de truands. Peggy tenait si peu à être gogo-girl qu’elle a saisi la première occasion pour se tirer de là. Cette occasion, c’était moi.
J’avais décidé de prendre quelques jours de repos. Nous les avons passés ensemble dans ma chambre d’hôtel. Nous sortirons peu. Moi je descendais de temps à autre, roulais jusqu’à un coffee-shop pas loin, j’avalais un sandwich ou un truc comme ça, avec une bière. Je remontais dans la chambre avec un sandwich pour elle et du café. Elle avalait le café, et souvent c’est moi qui plus tard mangeais le sandwich. T’es une sainte. Je lui disais. Elle répondait, en imitant la voix de Marlene Dietrich, je veux vivre de sexe et d’eau fraîche.
J’avais une autre raison de rester collé à l’hôtel. J’étais sur la piste d’un homme qui prétendait détenir des informations de première main sur le sort d’un certain nombre d’enfants réfugiés qui avaient été séparés de leurs familles à la suite de décision administrative, ils étaient détenus dans des conditions pénibles, privés de nouvelles de leurs parents, soumis à des pressions. Outre ces révélations, m’intéressait le personnage lui-même. C’était d’après une consœur de la presse locale, un ancien agent de la CIA, amoureux d’Haïti, ravagé par la mauvaise conscience, plein de remords quant à son rôle dans le sort de ces enfants et prêt à lâcher des informations sur l’ensemble du dossier des boat-people. Il voulait bien me voir. Il téléphonerait.
Il n’avait toujours pas appelé quand j’annonçai à Peggy mon intention de recommencer à travailler le lendemain. Elle a alors remplacer le mot sexe par le mot amour. T’as compris ?
Elle me fixait d’un air bizarre. T’es folle. Elle s’est fendue d’une tirade comme quoi elle allait larguer ses études et venir à Paris, oh pas pour vivre avec moi, elle savait guère ce qu’était ma vie, elle voulait voler de ses propres ailes, et m’aimer, être là, pour moi, elle disait.
Elle a répété ça, en plantant dans mes yeux son regard clair. Etre là. Pour toi.
La dernière fois que j’avais entendu une parole semblable, la fille avait fini dans un asile psychiatrique, avec vingt-quatre points de suture au visage. Le pauvre mec qui prétendait l’aimer l’avait démantibulée. Par jalousie, ou parce qu’il était dérangé. J’ai déclaré à Peggy que j’avais entendu ça une ou deux fois dans ma vie, ça ne m’avait pas tellement réussi, ça m’avait fait mal, je dirais même très mal. D’ailleurs je portais la poisse. Elle a répliqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi les mecs avaient tellement peur de l’amour, j’avais peur, ça lui paraissait évident, j’étais un lâche c’est tout ce que j’étais, à ne pas tenter d’attraper l’amour. Comme un mirage, j’ai fait.
Avec un filet à papillon. En pensant, comme d’habitude, après tout pourquoi pas ? J’ai fait le geste de capturer ledit mirage.
Elle a levé la main devant mon visage, retenant en l’air le geste d’une gifle, elle a fait ça en pinçant sa lèvre, ses dents luisaient comme une menace. La scène dura quelques secondes, je la revois encore : ça n’avait rien à voir avec la violence de nos corps emmêlés, c’était une violence d’enfant meurtrier. Un fracas de mort dans la tête.
Je lui ai dit que d’être restée trop longtemps ainsi, sans se nourrir, sans sortir, sans s’aérer la tête, ça lui avait sûrement pété les neurones. Qu’on allait vite fait piquer une tête dans la piscine. Après on verrait. Elle s’est animée, a ramassé son en toile dans le fond du placard, sorti un maillot de bain vert, des lunettes noires, un flacon d’huile solaire. Dans la salle de bains j’ai pris deux de ces serviettes larges comme des draps de lit.
Du balcon qu’il fallait longer vers les ascenseurs, on voyait deux types s’agiter sur le court de tennis. Le soleil disparaissait en ouest. Elle a chaussé les lunettes en reniflant. J’ai tiré la porte à glissière derrière nous.
Nous nous sommes installés à une table ronde et blanche, sous le parasol que Peggy m’a demandé de réorienter, j’ai réorienté, le soleil pour elle, l’ombre pour moi. Nous avons commandé deux sandwiches avec de la bière. Le serveur, un petit Haïtien sec, nous a regardés d’un air navré, la cuisine n’ouvrirait pas avant je ne sais plus quelle heure le bar était à notre service, Peggy n’avait envie de rien d’autre, ou si, peut-être d’un.
Le serveur s’est éloigné en disant attendez voir. Il est revenu avec deux sandwiches (du thon, de la laitue, des tomates, de la mayonnaise, dans du pain de mie). Il espérait qu’ils feraient l’affaire, c’est tout ce qu’il avait pu trouver, bien sûr ils font l’affaire, merci vieux frère.
Peggy a foncé sur le plateau, s’est emparée d’un sandwich, a mordu dedans avec un appétit inattendu. Dieu je revis, elle a dit, au diable ce régime.
J’ai versé la bière dans le verre en pensant que me tromperais toujours sur le sens de toutes choses. Le petit Haïtien est revenu. Quelqu’un me réclamait au téléphone. On me passait la communication sous la paillote à côté, un bar où je dénichai, coincé entre deux piles de plateaux en instance d’évacuation, un affreux combiné bleu en forme de sirène. Je pose mes fesses sur un tabouret, en coulant un oeil vers Peggy, elle s’était levée, je voyais son dos nu sous les bretelles du maillot nouées au cou, laissée glisser dans la piscine, elle avançait en projetant devant elle des petites gerbes d’eau, comme si elle jouait avec des baigneurs invisibles.
C’était le type du scoop. Il a pris un air de conspirateur, me fixant un rendez-vous en un lieu impossible. Tout de suite ? Bien sûr tout de suite. Okay j’arrive.
J’ai couru jusqu’à la piscine, prévenu Peggy, accordant peu d’attention à sa mine contrariée, je ne savais pas quand exactement je rentrerais, elle pouvait continuer de se baigner tranquille, utiliser la chambre à sa guise, m’attendre ou pas, sortir, revenir, bref ce qu’elle voudrait.
Le type de la CIA était un grand gaillard au crâne chauve. Il se prénommait Robert. Call me Bob. Je lui avais suggéré qu’on déguerpisse du quartier pourri où il m’avait fait venir. Nous étions assis à la terrasse d’un café, sur le petit port, de plaisance où il avait amarré son bateau. Il m’apprit une par de l’histoire. suffisamment pour envoyer au journal un papier valable. Fou ce que les gens parlent parfois. Pas assez cependant pour éclairer ma propre vie. Fou ce que les gens savent se taire en parlant.
Le soleil a plongé d’un coup dans la mer. En est, il y avait ma terre de naissance. Bob a émis une plaisanterie sur la différence de caractère chez les mouettes et les chiens suivant le degré de démocratie dans les pays. A Port-au-Prince, il suffisait de se baisser pour ramasser une pierre, les chiens fuyaient. Quant aux mouettes, elles se tiennent à distance respectable des humains.
Puis j’ai roulé dans la ville, sans itinéraire établi. Je me souvenais. Je me souvenais d’un jour. J’étais gosse, je faisais partie des méchants. Nous avons lapidé un chien à mort. Je me souvenais.
Je suis rentré tard dans la nuit, soûl comme pipirite, Peggy n’était nulle part. Je me suis déshabillé dans la salle de bains, me suis lavé les dents. j’ai avalé un comprimé d’aspirine. Je suis retourné dans la chambre. J’ai tiré les rideaux, comme d’habitude, à cause des lumières du court de tennis. Je me suis couché.
Puis il y eut le bruit de la porte à glissière. La silhouette dans la chambre. J’ai allumé. Peggy tenait un couteau à huîtres dans la main. Elle portait un sweat-shirt jaune sur un caleçon long en stretch noir, des sandales en toile. Elle tanguait.
Je ne me suis levé. J’ai dit mais qu'est-ce qui te prend ça va pas non ? Elle s’est approché du lit, me dominant de son long corps vacillant. Elle a brandi le couteau vers moi. J’ai reconnu le couteau d’un restaurant sur le front de mer où les gens vont se déchaîner à coups de massette sur les crabes et les langoustes. Ferdinand je vais t’arracher les yeux.
Sa voix était aussi empâtée que son visage. C’est la seule fois dans ma vie où les rudiments de combat au corps-à-corps acquis dans l’armée française m’auront servi à quelque chose. Je l’ai prise dans mes bras. Sa poitrine se soulevait à un rythme dingue. Elle puait l’alcool et le tabac. Tu es un monstre, elle a dit, martelant mon dos du poing. Je sais, je sais. J’en savais foutre rien. Si j’ai replongé.
Il y eut donc Peggy, le dernier jour de Peggy, elle disait qu’elle avait envie d’être une chaise de jardin, j’étais un oiseau, elle avait envie de vivre un peu avec moi le soleil
la pluie
la neige
le vent
Ma blessure vient de trop loin.
J’appelle ainsi, 'Tentatives de Fugue', tous ces moments où, d’être resté trop longtemps campé dans la nuit d’un pays, dans le demi-jour d’une langue, dans des codes, mon corps aura dit non, et qu’il faut aller ailleurs, partir vers de nouveaux lieux, vers d’autres langues, vers d’autres codes. On peut y perdre ses yeux.
Voilà l’envers de récits que je fis à l’époque, inutile à la télévision, politiquement inutile, seule la littérature peut accrocher avec efficacité cette part de nuit dont le Guyanais Wilson Harris me souffle que “je m’éveillais avec un œil mort qui voyait et un œil vivant qui restait fermé”. La littérature est du côté de l’œil mort des aveugles qui voient, le monde ne lui échappe pas. Voilà pourquoi je m’efforce toujours d’obtenir les moyens du “journalisme” pour finir par écrire. Là aussi, tentative de fugue.
Jean-Claude Charles
***