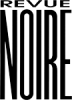Des chants de plastique aux chairs à vif
par Jean Loup Pivin
Un jour, au milieu d'une foule, je trouve dans mon sac, une main. Une main d'homme, comme morte. Je la prends, surpris et effrayé et la sors comme on sort un objet d'un sac. La main est suivie d'un bras. Le bras appartient à un corps. Un corps entier avec un visage. Le visage me sourit avec un haussement d'épaule d'impuissance et disparaît, sa main avec. La queue est peut-être ainsi, une queue sans corps ni tête. Le vagin, la bouche, les yeux : tout ça sans corps ni tête. Et si la tête peut ânonner la panoplie des raisons à porter un préservatif, à être fidèle, à comprendre et aider les sidéens, le corps et ses pulsions peuvent exclure le sidéen, ne pas porter de préservatif et continuer à butiner le pollen de la mort. Pourtant, on peut butiner avec une capote.
On peut choisir de ne pas risquer de mourir. On peut aussi choisir de le risquer. Mais ce choix est celui de l'individu entier, corps et esprit. Et celui de personne d'autre, ni celui de la radio, ni celui du porteur professionnel de bonne parole ou du médecin. Le silence caché par les bavardages, est un suicide. Le silence de l'âme, du cœur, du courage, pas celui de la bouche qui parle.
A l'Ile Maurice, lors de l'abolition de l'esclavage, une troupe de soldats est allée annoncer la bonne nouvelle à un groupe d'esclaves fuyards réfugiés au Morne de longue date. A la vue des militaires, sans chercher à comprendre, les hommes, avec femmes et enfants, se sont jetés du haut de la falaise pour ne pas se faire reprendre, pour ne pas avoir à lutter. Rien entendu, rien vu, rien vécu sinon la solitude de l'homme traqué qui, quand il est découvert, se suicide. La métaphore ne tient qu'à elle même et ne peut avoir d'autre vérité que celle de l'image. Mais on ne peut s'empêcher de dire qu'à un certain moment, il n'existe plus de raisons autres que celles qu'il faut chercher au fond de soi-même. Il n'y a plus de justifications à rien.
Que l'extérieur soit responsable ? Et alors ? Quand la tempête arrache le toit de sa maison, on le reconstruit en essayant de le faire plus solide, on ne va pas demander réparation au vent. On construit plus solide. Plus solide. Une société qui refuse de construire son toit et qui ne cherche qu'à le faire reconstruire par ceux qui l'ont détruit reste tout simplement sans toit. Esclavage, colonie, infection de tous les maux d'importation du matérialisme marxiste ou libéral aux religions monothéistes totalitaires, de la haine armée à la syphilis de l'amour rôdent dans les têtes et les paroles, pour se lancer plus à soi-même qu'aux autres, la justification de son impuissance délibérée.
L'Afrique a caché longtemps les visages du sida pour les transformer en berceuse de propagande en plastique et la communauté internationale en nuées de chiffres douteux et souvent aléatoires. Le premier mort sans visage aurait dû suffire pour être le martyre d'une Afrique qui refuse de se regarder en face et pour qu'enfin le visage de la mort prenne le nom de la faillite des sociétés. A force de ménager on ne sait quelle pudeur sociale, l'Afrique serait-elle vraiment devenue le continent du non-dit et du non-faire, assujetti à une fatalité génétique ? Le scandale, ce n'est pas l'oubli partiel volontaire ou involontaire des pays riches, mais la léthargie et le refus de l'Afrique à se prendre en mains et dans ce cadre, et ce cadre seulement, à solliciter l'aide et faire pression sur l'opinion publique internationale pour obtenir le même droit à la santé, toute la santé, que partout ailleurs. Le sida pendant dix ans n'a été qu'une confrontation de l'Afrique avec sa solitude, avec la solitude des siens. Rien n'était son problème puisque seule la société répondait à tout. Tout est devenu notre problème puisque la société ne répond plus à rien.
Il est temps d'envisager une filiation nouvelle qui s'appuie sur le glissement des notions de territoire, de couleur et d'identité, vers d'autres notions construites, de fait, par la ville, notre ville à tous. Les sociétés d'aujourd'hui à l'histoire imaginaire et plus encore demain, se forgent aux caractères distincts des individualités, seules devant leur futur. Le corps isolé, dans la foule des envies, des désirs et des besoins. Il se retrouve partout dans le monde, l'individu qui cherche ses frères pour ne trouver que la solitude de sociétés qui n'arrivent pas à affirmer de nouvelles valeurs débarrassées de tous les archaïsmes sanguinaires. Mais connaît-on ces valeurs ? L'aveuglement du passé a-t-il jamais permis de les voir éclore ici et là ? Les maux les plus menaçants ne sont-ils pas l'occasion de les révéler ? Mais qui aujourd'hui peut dire ou donner une forme à ces valeurs ? Le politique, le sage, le poète et celui qui, atteint ou malade, souffre dans sa tête et son corps ? Seul le citoyen en sortant de son invisibilité peut jeter à la face des autres le trouble d'une différence contagieuse. Une différence contagieuse, moins liée à la maladie qu'à l'obligation de regarder différemment chacun pour qu'il ne soit plus un autre à repousser, mais un autre soi-même. Le schéma de la différence ne peut plus être celui, convenu de la culture, de la couleur, du sexe ou de la maladie. Comme si soi-même devenait mieux soi-même en étant aussi de la couleur, du sexe et de la souffrance de l'autre.
La culture, ce n'est pas l'art d'emballer un propos objectif qui serait, dans le cas du sida, donner une forme aux messages pour le préservatif ou la fidélité mais bien un des moyens de toucher le sens profond des choses et de l'existence. La forme en sera belle ou laide, peu importe ; efficace, on le lui souhaite mais on ne peut pas l'exiger. C'est ce rapport de l'art à la réalité qui est affirmé dans sa nature comme étant essentiel. La vérité ne peut pas être entre les mains de l'homme à travers une science ou une religion instrumentalisées. Comprendre une société, c'est affirmer son appartenance à celle-ci, corps et esprit. Vouloir agir sur elle, c'est d'abord agir sur soi, pour laisser toutes les désespérances offertes chaque jour se substituer à l'espoir de sa propre dignité et de son propre respect. Les artistes dans la société ne sont ni des prêtres porteurs d'un message supérieur, ni des détenteurs de vérités objectives. Ils sont simplement dans le monde à se laisser pénétrer de ce qui en fait le sens, sans autre effet de réalité qu'une forme, une représentation toujours en mouvement.
Si les choses n'existent pas en dehors de la représentation que l'on s'en fait, il peut être possible que le sida qui est en principe une maladie objective, n'existe pas en dehors de celui qui en meurt. Quand de plus, en Afrique, on ne meurt jamais du sida mais de toutes les maladies opportunistes et de toutes les prédestinations, on voit bien qu'une société peut refuser qu'une maladie objective touche aux essences mêmes de la vie qui sont le désir de reproduction et l'amour. Et que ça, c'est la vie, tout simplement.
La dichotomie sida maladie scientifique et sida maladie sociale voudrait que s'installent des rôles simples : les médecins pour soigner, les créateurs-philosophes pour convaincre ou parler. La théorie pourrait faire incarner à l'art ce rôle de dire l'indicible, car par une autre représentation du monde, il fait sens là où la raison devient impuissante. Pourtant cette mise à l'écart de l'art dans la boîte de la raison, fait la raison défaillir et l'art se perdre. Car l'être pensant et l'être aimant sont les mêmes.
Ce n'est pas l'artiste qui est communiquant, c'est son œuvre qui offrira une forme dans laquelle certains entendront l'écho du monde. Les artistes qui font des œuvres en pensant au sida ne sont pas des militants de la cause d'un autre, mais des êtres qui souffrent au même titre que d'autres d'un même mal. « J'ai le sida » dit Georges Adeagbo pour dire qu'il n'y a pas de réalité qui lui échappe métaphoriquement sans le transpercer lui-même. L'artiste n'est pas le media d'une société et d'un univers, mais le medium de la société, du cosmos, des replis de ses désirs et de tous les inconscients prémonitoires d'un autre monde. Il devient cosmos, société et désirs à travers ses œuvres, le temps de ses œuvres. Et par elles, il forge cet autre monde où la blessure, la déchirure comme les caresses du désir s'enroulent autour d'une même raison éclairée. A l'être croyant qui n'aimerait que croire, à l'être cartésien qui n'aimerait que raisonner, à l'être aimant qui n'aimerait que vivre ses amours, se substitue un être, ici et là, qui finalement est chacun de nous avec sa peur et son courage, sa croyance et son incrédulité, son amour et sa haine, sa raison et son irrationnel. Avec au centre de son corps, pour balancier, selon chacun, la peur, la raison, l'amour ou la croyance. L'artiste n'est autre que chacun de nous. Avec ou sans la possibilité de s'exprimer à travers une œuvre, un chant ou un pas de danse. Les Artistes Africains et le Sida ont fabriqué des œuvres chantées, dansées, peintes, filmées, écrites, photographiées pour dire simplement cette autre réalité. Avec, toujours en mémoire, l'idée que chacun, après, serait un peu moins sûr de soi et un peu plus sûr des autres.
Des autres comme autant de parties de soi.
Pour ne pas mourir totalement.
***
par Jean Loup Pivin
(texte publié dans le magazine Revue Noire RN19, Les artistes africains et le Sida, décembre 1996)
.